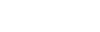Les coucous du verbe
Un basculement discret, mais frappant dès lors qu’on en prend la mesure, se produit dans le paysage des médias et de l’illustration : plus le dessin de presse et sa cousine la BD conquièrent des périmètres allant s’élargissant, plus la part du texte et du verbe dignes de ces vocables, c’est-à-dire portées par le style et la personnalité, s’érode en entraînant leurs auteurs dans les mélancolies de la déconfiture et du fatalisme.
Des coucous dans le nid des écrivant, en somme. À partir de là s’égrènent quelques constats nourrissant l’hypothèse d’une régression langagière massive, non seulement dans les journaux mais fondamentalement dans la Cité.
À propos de la bande dessinée, on comprendrait d’abord que son découpage de case en case est une façon de fragmenter le récit parfaitement conforme à notre époque — où l’existence de chacun progresse elle aussi sur un mode stroboscopique qui restreint le déploiement de sa mémoire au sein de la mémoire collective, tandis que crépitent dans les actualités les scoops et les titrailles en points d’exclamation majeurs.
On observerait ensuite les dessinateurs de presse en s’interrogeant sur leur statut furieusement symptomatique, qui les voit triompher sous nos latitudes en termes de popularité comme de rémunération — qu’ils ont d’ailleurs le loisir exceptionnel d’élargir en puisant leurs gains à plusieurs sources. Ce qui les transforme en vedettes internationales ou vernaculaires douées d’un pouvoir incomparablement supérieur à celui des artisans du verbe encore chargés de façonner du reportage ou du commentaire.
On se pencherait plus tard sur le saint des saints de la bande dessinée francophone, ce Titeuf égaillé sur tous les étals de librairie disponibles, en qui l’on verrait l’archétype du futur adulte un peu vil à l’oeuvre dans nos sociétés actuelles, plus soucieux de débrouillardise que d’esprit sauvage, travaillé par le sexe et le cul au mi-chemin le plus touchant du mélodrame et du cliché, et figuré sans originalité particulière, sur la base d’un module graphique décliné comme un logo de marque sympathique.
Et l’on noterait encore à propos du même Titeuf, pour secouer l’emblème encore un chouïa, que son parler forme à lui seul un toboggan de la pensée, avec ce « pô» qui drague les sous-lettrés comme un point de ralliement monosyllabique idéal. Bref, on compilerait là tous les symptômes d’un effondrement de l’expression signifiante, au voisinage desquels on ne s’étonnerait plus guère d’apercevoir le caca fumant à répétition sur la couverture des plus honorables magazines allant jusqu’au genre intello version Charlie.
Bien sûr, il faudrait analyser tous ces signes jusqu’au bout. Établir que le succès d’un Titeuf révèle à la perfection nos sociétés humaines désarticulées au fond mais agréables en surface, où l’oeillade et le racolage tiennent lieu de la fraternité pratiquée qui s’absente au moment des migrants. Et démontrer que l’emprise des dessinateurs de presse repose sur leur accord subreptice avec les injonctions de notre époque, qui les invite à simplifier l’information davantage qu’à la ramifier d’une manière pouvant aiguiser la lucidité citoyenne en général.
Voilà. On respire un instant. De quoi percevoir à quel point la parole est souffrante en nos sociétés bruyantes et nos médias prolixes, où les journalistes sont invités à n’adopter qu’absence de style, présumée racoleuse pour le grand public, et qu’absence de singularité vive. Où la production littéraire tourne à toute allure de stocks en librairies puis en entrepôts laminés par le pilon. Où Le Matin quotidien quitte son papier sans susciter, phénomène inouï, l’ombre d’une critique ou d’une autocritique à l’endroit de son contenu.
Alors je pense à L’Adieu au langage de Jean-Luc Godard, dont l’intitulé m’effraie. Puis je pense aux exceptions les plus heureuses. À Pratt, à Tardi, à Bilal et quelques autres, dont le talent façonne une atmosphère. À Martial Leiter, dont la trajectoire se déroule aux confins de la presse comme à l’orée de l’art. À quelques jeunes aussi, mais dont j’ignore encore le nom. À ceux, en somme, soient-ils dessinateurs de presse ou créateurs de bandes dessinées, qui produisent des oeuvres à la fois contestataires, mélancoliques et poétiques. Qui produisent un effet de prégnance magistrale au-delà du potache primaire et de la bulle creuse. Qui propulsent leur lecteur loin du livre et de l’immédiat. Qui sont les plus rares. Je les révère.